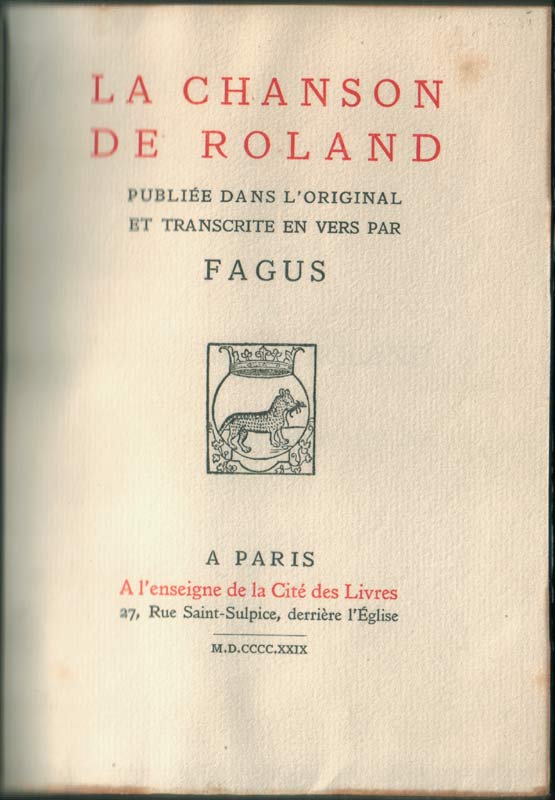Publié en 1929 à l’enseigne de la Cité des Livres.
300 p.
Avant-propos de Paul Léautaud.
Table des matières :
Introduction
La Trahison
Roncevaux
Le Cor de Roland
La Vengeance de Charlemagne
Le Châtiment de Ganelon

Le livre et la critique :
- Henri Martineau, Le Divan, janvier 1930, pp. 87-88 :
Parmi les ouvrages importants et nombreux qui ont ces derniers mois enrichi la bibliothèque classique de la Cité des Livres, il faut citer en tête la Chanson de Roland qui donne le texte original et en regard la translation en vers de FAGUS. Je n’ai pas à présenter Fagus aux lecteurs de cette revue : ils connaissent ce gentilhomme de lettres qui ne se console pas de respirer en un autre temps que celui d’un moyen âge pour lequel il conserve son amour et sa foi. Aussi, abordant aujourd’hui la Chanson merveilleuse de Roland il n’y porte qu’une main pieuse et il la transcrit vers à vers en lui conservant, autant qu’il se peut, son rythme et ses assonances. Son goût propre des formes anciennes, sa dilection pour les vieux mots pleins de suc, sa connaissance des vieilles légendes et des vieux chants français le prédisposaient à ce travail patient qu’il a mené à bien avec le scrupule d’un érudit et l’enthousiasme d’un poète. Mais, nous reprendra ici un Fagus courroucé, quel pauvre qui ne serait pas un érudit et quel érudit ennuyeux qui par surcroît ne se révélerait poète !.
- Charles Baussan, extrait de « La Chanson de Roland et ses deux jongleurs », La Croix, 19 janvier 1930, p. 3 :
La Chanson de Roland en a trouvé un autre aujourd’hui : Fagus. Quelque nombreuses éditions, quelque nombreuses traductions que l’on ait de la Chanson de Roland, la traduction, ou, pour parler plus exactement, la « transcription » n’en avait jamais été donnée de la manière la plus naturelle et la plus proche de l’original.
La plupart des traductions sont en prose et c’est déjà une infidélité : « On est inexact et de la pire des inexactitudes, dit M. Joseph Bédier lui-même, du seul fait que l’on transcrit en prose un ouvrage de la poésie. Privée de la forte cadence des décasyllabes et de la sonorité des assonances, la strophe du vieux trouvère n’est qu’un moulin sans eau. Que de fois, au cours de mon travail, me suis-je remémoré, avec mélancolie, certain chapitre, très sage, de la *Défense et illustration* de Joachim du Bellay : « de ne traduire les poètes ! »
Mais si l’on est poète ?
Deux poètes avaient traduit en vers la Chanson de Roland ; mais l’un, le baron d’Avril, l’avait traduite en décasyllabes blancs ; l’autre, M. Henri Chamard, en alexandrins. Ni dans l’une ni dans l’autre de ces deux traductions, la ressemblance, la fidélité ne pouvaient être complètes.
Fagus vient de faire mieux. La chanson de Turold est en décasyllabes : Fagus, dans sa transcription, la garde en décasyllabes ; elle est en vers assonancés, Fagus garde l’assonance. L’assonance, cette grand’mère de la rime, cette similitude de son portant seulement sur la dernière voyelle ou diphtongue sonore du vers, cette grand’mère qui vit toujours, qui chante toujours dans les complaintes et les rondes populaires, pourquoi, lorsque l’ont veut échapper à la contrainte de la rime, n’y revient-on pas, à cette assonance, au lieu de s’égarer dans les chemins décevants des vers blancs ?
En tout cas, Fagus a fait pour la Chanson de Roland ce qu’il fallait faire et ce que personne n’avait fait avant lui. Nous avons aujourd’hui, dans cette édition que la Cité des Livres donne avec son élégance habituelle, deux textes en regard l’un de l’autre : d’une part le texte du manuscrit d’Oxford — le meilleur des manuscrits connus, — et, d’autre part, la « transcription » de Fagus ; à droite comme à gauche, des laisses de longueurs inégales ; à droite comme à gauche, des décasyllabes assonancés.
Fagus, un des meilleurs poètes de ce temps, est plus qu’un traducteur, plus qu’un transcripteur ; c’est un véritable jongleur, de la lignée des autres, qui continue les autres, dans le même esprit et dans le même sentiment, et on l’imagine très bien chantant sa geste devant des féodaux, s’il y avait encore des féodaux.
Tout d’abord, et comme il convenait, il connaît à fond non seulement sa chanson, mais l’histoire de sa chanson, et il la raconte en une introduction pleine et claire. Mais avant tout il est poète, un poète de la race de Villon et de La Fontaine, un poète qui a, à un degré merveilleux, le sens du mot de France et de sa musique.
Est-ce lui ou le jongleur Turold qui chante ? On ne sait plus, tant le parler est le même, et pareils le ton de la voix, le mouvement, la cadence, tant les deux laisses se ressemblent, en face l’une de l’autre, et sortent de deux cœurs qui se touchent, par-dessus huit cents ans, dans la pérennité de l’âme française !
Écoutez Roland pleurant ses compagnons :
Seigneurs barons, de vous ait Dieu merci.
Et qu’à votre âme octroyant paradis,
En saintes fleurs il vous fasse fleurir !
Meilleurs vassaux que vous jamais se vit.
Tous m’avez-vous si longuement servi,
Et pour le roi tant de pays conquis !
Pour quel destin vous avait-il nourris :
Terre de France, êtes si doux pays,
Toute en exil de votre baronnie !
Barons français que pour moi vois mourir,
Qui ne vous sus défendre et secourir,
Vous aide Dieu, qui jamais ne mentit !
Ou cette harangue de Charlemagne avant la bataille :
Barons français, vous êtes bons vassals,
Tant de batailles ensemble avons livrées !
Tous ces païens, voyez, félons, couards,
Toute leur foi ne vaut pas un denier.
Que soient nombreux, seigneurs, qu’importe aux braves !
Qui ne m’y suit, à l’instant qu’il s’en aille !
Restè-je seul, tout seul, je les assaille !
C’est, ligne à ligne, une nouvelle Chanson de Roland, exactement juxtaposée à l’ancienne et toute pareille. La seule différence est que, dans celle de Fagus, la langue est celle du XXe siècle, et encore les mots du nouveau jongleur sont de si vieille lignée, qu’ils s’aperçoivent fils des mots de Turold, et de même le tour de la phrase et la cadence.
C’est l’ancien jongleur qui chante, mais c’est aussi le nouveau. Tout en se condamnant, en son beau devoir, à suivre fidèlement son devancier, le jongleur Fagus n’a pas seulement présenté à nos oreilles du XXe siècle, dans toute sa vérité, dans toute sa jeune beauté, l’antique chanson de Turold, il a fait lui-même une grande œuvre personnelle, une grande œuvre de poète, de rythme et de simplicité, de puissance souvent et parfois de douceur berceuse, une œuvre dans laquelle remonte et s’épanouit en feuilles et en fleurs la sève des mots et des sentiments d’autrefois. Le moulin a son eau, et si ce n’est pas tout à fait ie même moulin que jadis, c’est le même ruisseau qui fait tourner la roue.
La chanson de Roland a désormais deux jongleurs, deux frères : Turold et Fagus.